Fresque :
histoire et technique de peinture  Automatique traduire
Automatique traduire
La fresque est la plus ancienne forme de peinture monumentale, réalisée avec des peintures à l’eau sur du plâtre frais et humide. Son nom vient de l’italien « fresco » qui signifie « frais ». Une fois sèche, la chaux contenue dans le plâtre forme une fine pellicule de calcite transparente, qui confère à l’image une grande durabilité. La technique de la fresque existe depuis plusieurs millénaires et s’est développée dans différentes régions du monde, laissant à l’humanité des œuvres d’art inestimables.

2 Peinture à fresque antique
3 La fresque dans l’art médiéval
4 L’essor de la fresque à la Renaissance
5 Aspects techniques de la création de fresques
6 La fresque dans le contexte de l’art mondial
7 Conservation et restauration des fresques
8 Pline l’Ancien sur la peinture et les fresques
9 Innovations techniques et évolution de la fresque
Les origines de la peinture à fresque
La date exacte de l’apparition des fresques est inconnue, mais des découvertes archéologiques indiquent que dès le IIe millénaire avant J.-C., à l’époque égéenne, la peinture à fresque était répandue. La civilisation minoenne, présente en Crète, a laissé des exemples remarquables de peintures murales représentant la faune marine, des scènes rituelles et des épisodes de la vie quotidienne.
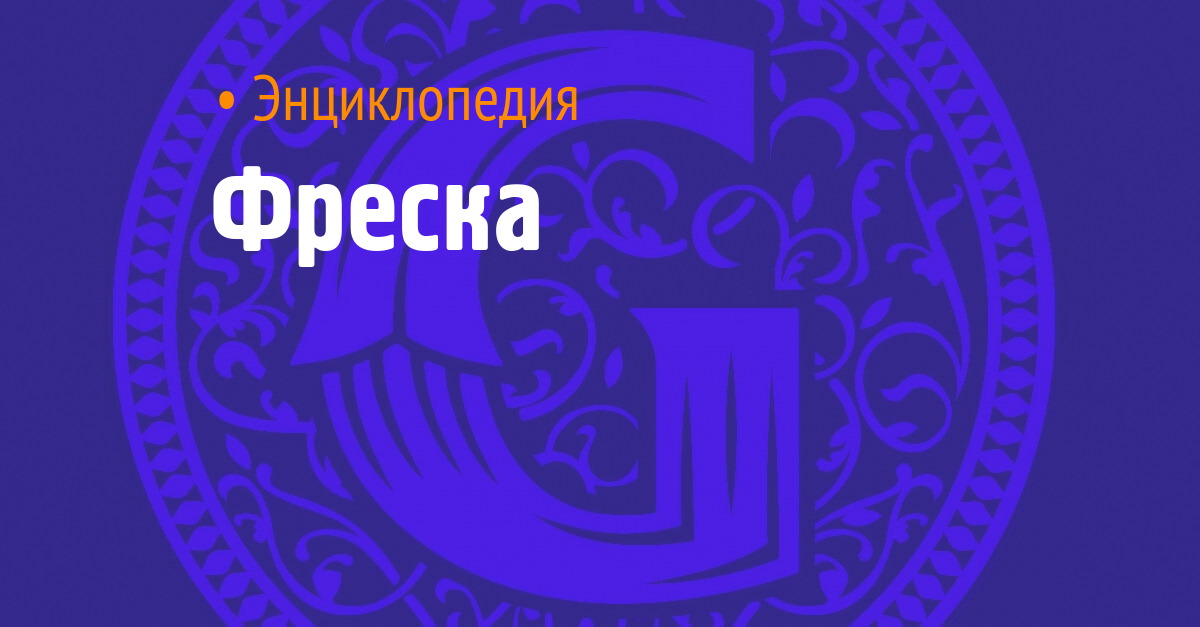
Peinture fresque
Qu’est-ce que la peinture à fresque ? Caractéristiques Le terme artistique Fresque (italien «frais») décrit une méthode de peinture, dans laquelle les pigments colorés sont mélangés uniquement à de l’eau (sans liant) puis appliqués directement sur un enduit de chaux fraîchement posé (surface apprêtée au plâtre).
Les fresques du palais de Cnossos en Crète, telles que « Les Dames en bleu » et « La Parisienne », se distinguent par leurs couleurs vives et leurs images expressives. Les Minoens utilisaient une technique proche de l’alsecco, où la colle ou la caséine servaient de liant.
L’Égypte ancienne, l’Assyrie, la Babylonie et la Phénicie possédaient également leurs propres traditions de peinture murale à la chaux. Les mélanges de chaux étaient utilisés non seulement à des fins artistiques, mais aussi pour créer des mastics résistants à l’humidité dans la construction d’aqueducs et d’ouvrages hydrauliques.
Des mélanges de chaux de haute qualité étaient utilisés dans les bâtiments résidentiels et les palais de la culture égéenne, servant de support aux peintures murales. Cependant, même ces mélanges sont classés sous condition comme fresques « sur humide », car ils présentent des différences technologiques significatives avec la technique de la fresque classique, développée ultérieurement.
Peinture à fresque antique
Dans l’Antiquité, la peinture à fresque atteignait un haut niveau de maîtrise. La disponibilité des matériaux (chaux, sable, minéraux colorés), la relative simplicité de la technique et la durabilité des œuvres ont déterminé la popularité de la fresque dans la Grèce et la Rome antiques.
Les découvertes réalisées dans les villes ensevelies par l’éruption du Vésuve en 79 après J.-C. – Pompéi, Herculanum et les villas environnantes – sont particulièrement précieuses pour l’étude de la fresque antique. Grâce aux cendres volcaniques qui ont préservé ces villes, de nombreuses fresques aux couleurs vives ont survécu jusqu’à nos jours.
Pompéi fut découverte par hasard au début du XVIIe siècle lors de la construction d’un aqueduc. La ville se libéra progressivement de la couverture volcanique, et le monde put admirer des exemples uniques de fresques antiques. Paradoxalement, l’éruption qui détruisit la ville la préserva pendant des siècles et lui valut une renommée mondiale.
Les fresques de Pompéi étonnent par leur état de conservation et l’éclat de leurs couleurs, même après des millénaires. Selon les chercheurs, les artistes locaux utilisaient une technique particulière, dont le secret n’a pas encore été entièrement percé à ce jour. La simplicité et la virtuosité des fresques émerveillèrent Renoir lui-même, qui visita Pompéi en 1881.
Les fresques romaines étaient créées non seulement pour le plaisir esthétique, mais aussi pour une fonction pratique : elles agrandissaient visuellement l’espace des pièces et rendaient les intérieurs plus lumineux et aérés. Dans des conditions de faible luminosité naturelle, cet aspect était particulièrement important.
Quatre styles de peinture pompéienne
Les chercheurs identifient quatre principaux styles de peinture pompéienne, qui reflètent l’évolution de la technique de la fresque et des préférences artistiques dans la société romaine :
- Le premier style (IIe-Ier siècles av. J.-C.) est celui de la marqueterie, imitant les revêtements muraux en marbre coloré. Il se caractérise par des formes géométriques et des couleurs locales vives.
- Le deuxième style (Ier siècle av. J.-C.) est celui de la perspective architecturale, créant une illusion d’espace en représentant des éléments architecturaux en perspective. Les murs semblent s’écarter, révélant des vues de paysages, de villes et de sanctuaires.
- Le troisième style (fin du Ier siècle av. J.-C. – milieu du Ier siècle apr. J.-C.) est celui des candélabres ou ornements. Le mur est perçu comme un plan orné d’élégants ornements, de paysages miniatures et de scènes mythologiques.
- Le quatrième style (milieu-fin du Ier siècle après J.-C.) est fantastique ou illusionniste. Il combine des éléments de styles antérieurs avec des formes architecturales fantastiques, créant des compositions décoratives complexes.
La fresque dans l’art médiéval
Au Moyen Âge, la fresque devint la forme d’art monumental la plus importante du monde chrétien. À Byzance, elle acquit une importance particulière, notamment lors du déclin de l’empire, lorsque la création de mosaïques coûteuses devint économiquement difficile.
Les fresques byzantines se distinguaient par leur caractère canonique strict, la subordination de l’image à l’architecture et aux idées théologiques. Elles représentaient des scènes religieuses, transmettant les valeurs spirituelles et culturelles de leur époque. Parmi les exemples notables, citons les fresques de l’église d’Evangelistria à Geraki et de l’église du Christ-Sauveur-aux-Champs.
La fresque, en tant que moyen de transmission visuelle de sujets religieux, est devenue un reflet du contexte culturel de la société byzantine. Elle remplissait une fonction didactique importante, représentant clairement des sujets bibliques pour la population illettrée.
Fresques de l’ancienne Rus’
En Russie antique, la peinture monumentale est apparue avec l’adoption du christianisme sous les princes Vladimir (980-1015) et Iaroslav le Sage (1019-1054). Au fil des siècles, les maîtres russes ont adopté l’art des « Grecs » (nom donné aux Byzantins parlant grec).
La technique de la peinture murale dans la Russie antique était principalement mixte : la peinture à l’eau sur plâtre humide était complétée par la technique de la tempera et de la colle avec divers liants (colles d’œuf, animales et végétales). Les fonds et les peintures supérieures étaient souvent réalisés selon la technique de l’alsecco.
Pour décorer les églises de Kiev de mosaïques, un atelier spécial fut construit, où étaient fabriqués des smalts de différentes couleurs. Les compositions du dôme et de l’abside furent réalisées selon la technique de la mosaïque, la plus coûteuse et la plus complexe, tandis que le reste du temple fut peint de fresques.
Les fresques de la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, réalisées à l’époque de Iaroslav le Sage, sont les monuments les plus précieux de l’art russe antique. Au zénith de la coupole centrale, dans un médaillon, se dressait une immense image du Christ Tout-Puissant à mi-corps, entourée de quatre archanges.
L’essor de la fresque à la Renaissance
En Europe, à la Renaissance, la maîtrise de l’art de la peinture murale devint l’un des principaux critères de compétence d’un artiste. C’est en Italie, à cette époque, que la fresque atteignit son apogée.
Au début de la Renaissance, la peinture à fresque se répandit considérablement. La plupart des artistes italiens de cette époque étaient des fresquistes. Les réformes de la peinture à fresque, initiées par Giotto di Bondone, servirent d’école à des générations d’artistes italiens.
Les monastères rivalisaient d’imagination pour inviter des artistes célèbres. Des fresques magistrales couvraient les murs des anciens édifices encore gothiques, ainsi que des nouveaux bâtiments des provinces et des centres artistiques. Elles ornaient les façades et les intérieurs des églises, des palais, des chapelles et des bâtiments publics.
Les sujets des fresques étaient variés : scènes de l’Ancien Testament (par exemple, la Création d’Adam), épisodes de la vie et de la passion du Christ (l’Annonciation, la Cène, la Crucifixion), allégories (l’Allégorie du Sage Gouvernement), personnages mythiques (Hercule, les Sibylles), scènes de bataille et événements historiques.
À la Haute Renaissance, de grands maîtres de la fresque, tels que Raphaël (strophes du Vatican) et Michel-Ange (peinture de la chapelle Sixtine), travaillaient. La technique de la fresque exigeait de l’artiste une main sûre, une rapidité d’exécution et une idée précise de la composition. En une journée, le maître devait peindre une partie du mur avant que le plâtre ne sèche.
Le terme « buon fresco » ou « fresque pure » apparaît pour la première fois dans un traité de l’artiste italien Cennino Cennini (1437), où il décrit une technique de peinture sur plâtre frais. Cette technique, différente de la précédente, « al secco » (peinture sur plâtre sec), devient la principale méthode de création d’œuvres monumentales à la Renaissance.
L’un des aspects les plus importants de la création d’une fresque à la Renaissance était de la diviser en giornata, des sections que l’artiste pouvait peindre en une seule journée. Dans la célèbre fresque « La Sainte Trinité » de Masaccio, on distingue vingt-quatre giornata. En observant attentivement la fresque de haut en bas, on peut distinguer les différentes sections peintes en une seule journée.
Aspects techniques de la création de fresques
Types de techniques de fresque
Il existe trois principaux types de techniques de fresque, chacun ayant ses propres caractéristiques et applications :
- Le Buon fresco (en italien : buon fresco – véritable fresque) est la méthode la plus courante. Il utilise des pigments mélangés uniquement à de l’eau, sans liant. Les peintures sont appliquées sur une fine couche d’enduit à la chaux frais et humide (intonaco). Le pigment est absorbé par l’enduit et, une fois sec, s’y intègre, ce qui assure la durabilité de la peinture.
- La peinture al secco (en italien : al secco – sur le sec) est une technique de peinture sur plâtre sec utilisant un liant. Contrairement à la peinture buon fresco, elle nécessite un liant (par exemple, de la tempera à l’œuf, de la colle ou de l’huile) pour fixer le pigment au mur. Cette technique a été utilisée, par exemple, dans « La Cène » de Léonard de Vinci. La technique al secco offre un gain de rythme, permettant de peindre une plus grande surface en une journée de travail qu’avec la fresque, mais elle est moins durable.
- La mezzo-fresco (en italien : mezzo-fresco, demi-fresque) est une technique de peinture sur plâtre sec, mais pas encore complètement sec. Le pigment ne pénètre que partiellement dans le plâtre. Au XVIIe siècle, cette technique avait largement remplacé la buon-fresco sur les murs et les plafonds.
L’Alsecco est également appelé peinture à la caséine et au silicate sur plâtre sec. Il est utilisé pour les surfaces intérieures et extérieures des bâtiments. Cette technique permet des retouches ultérieures à la détrempe et un rinçage à l’eau claire.
Matériaux pour créer une fresque
Les matériaux suivants sont traditionnellement utilisés pour créer une fresque :
- Chaux de haute qualité (CL 90 ou supérieur selon la norme européenne EN 459-1)
- Sable de granulométrie variable (du grossier pour les couches inférieures au fin pour la couche finale)
- Pigments naturels résistants au calcaire
- Eau pour mélanger les solutions et les peintures
- Outils : pinceaux, spatules, truelles, règles, fils à plomb
La palette des fresques est assez sobre. On utilise des peintures qui n’entrent pas en contact avec la chaux. Traditionnellement, on utilisait des pigments naturels de terre (ocres, terres d’ombre), ainsi que du mars, du bleu et du vert cobalt. Les peintures au cuivre étaient moins utilisées en raison de leur activité chimique.
Le processus de création d’une fresque
Préparation de surface
La première étape de la création d’une fresque consiste à préparer le mur. On applique d’abord une couche de «gobetis», un enduit rugueux destiné à égaliser la surface. Puis, au plus tôt une semaine plus tard, on applique une couche d’«arriccio», une seconde couche d’enduit d’environ 1 cm d’épaisseur, composée de deux parts de sable et d’une part de chaux aérienne.
L’arrico sert à maintenir l’humidité pour la couche d’intonaco suivante, afin de prolonger au maximum la durée de peinture. Avant d’appliquer l’arrico, le gobetis est généreusement humidifié à l’eau pendant plusieurs jours. Après application, sa surface est rendue rugueuse pour une meilleure adhérence à la couche suivante.
Création d’un dessin préparatoire
Sur la surface préparée de l’arrico, l’artiste crée un dessin préparatoire : la sinopia. Son nom vient de la peinture rouge fabriquée à partir d’oxyde de fer extrait près de la ville de Sinop, sur la mer Noire. C’est le seul pigment rouge connu des artistes de l’Antiquité.
La sinopia a été largement utilisée par les peintres de fresques italiens jusqu’au début du XVIe siècle, lorsqu’elle a été remplacée par la technique consistant à presser un dessin préparatoire à partir de «papier calque» sur du plâtre humide à l’aide d’une poudre - la poudre de charbon de bois était appliquée sur le mur par des perforations, laissant un contour en pointillé.
Application de l’intonaco et de la peinture
La dernière couche d’enduit est l’intonaco, une fine couche (5-7 mm) sur laquelle est appliquée la peinture. L’intonaco est appliqué par petites sections (giornata), que l’artiste peut peindre en une journée, alors que l’enduit est encore humide.
Giornata (en italien : giornata, qui signifie « journée de travail ») est un terme important de la technique du buon fresco, décrivant la quantité de peinture pouvant être réalisée en une journée de travail. Cette quantité est basée sur l’expérience de l’artiste, en tenant compte de la quantité de peinture qu’il peut réaliser pendant les heures où le plâtre reste humide et où le pigment peut adhérer au mur.
Connaître la quantité de peinture pouvant être réalisée en une journée est crucial pour la technique du buon fresco. Généralement, le plâtre est appliqué de manière à épouser les contours du personnage ou de l’objet peint, de sorte que les segments diurnes soient invisibles.
Après avoir appliqué l’intonaco, l’artiste commence immédiatement à peindre, en utilisant des pigments mélangés uniquement à de l’eau. Le travail exige rapidité et précision, car les corrections ne sont possibles qu’en retirant la partie non réussie du plâtre et en appliquant une nouvelle couche.
Une fois le travail terminé, l’artiste gratte l’excédent de plâtre pour l’empêcher de sécher. Ce procédé permet à l’artiste de commencer le lendemain matin avec du plâtre frais et humide, prêt à être peint.
En séchant, la chaux contenue dans le plâtre réagit avec le dioxyde de carbone de l’air pour former du carbonate de calcium, qui crée une structure cristalline solide liant les pigments. Ce processus, appelé carbonatation, assure la longévité de la fresque.
Travaux de finition
Une fois la peinture principale sèche, l’artiste pouvait y apporter quelques ajouts grâce à la technique alsecco. Des détails, tels que de petits ornements ou des rehauts, étaient souvent ajoutés à la détrempe sur la fresque déjà sèche. Cela permettait d’obtenir plus de détails et d’utiliser des couleurs instables dans l’environnement alcalin de l’enduit à la chaux frais.
La fresque dans le contexte de l’art mondial
La fresque est restée l’un des principaux types d’art monumental pendant des millénaires. Elle décorait les murs des temples, des palais et des bâtiments publics, véhiculant des thèmes religieux, historiques et culturels de différentes époques.
La signification socioculturelle de la fresque
Dans la Rome antique, les fresques avaient non seulement une fonction décorative, mais aussi sociale, témoignant du statut et du goût du propriétaire de la maison. Pour les Romains, l’art était avant tout un moyen d’éduquer le citoyen romain idéal.
Les activités de Jules César, d’Octave Auguste et de Marcus Vipsanius Agrippa peuvent servir à étudier l’émergence des formes protomuséales dans l’Empire romain. En analysant la différence de perception de l’art entre les Grecs et les Romains, les chercheurs concluent que pour ces derniers, la fonction esthétique de l’art n’était pas primordiale.
Dans l’art chrétien, la fresque est devenue un moyen privilégié de décorer les murs intérieurs et (plus rarement) extérieurs des églises en pierre. Elle remplissait une fonction didactique importante, représentant clairement des récits bibliques pour la population illettrée ; c’était une sorte de « Bible pour les illettrés ».
À la Renaissance, la décoration murale à fresques acquit une importance particulière dans les intérieurs des palais de cette époque. La magnificence des pièces ne résultait pas d’un riche mobilier, mais d’une décoration soignée des murs, du plafond et du sol. Les fresques devinrent partie intégrante de l’espace architectural, soulignant et rehaussant son impact esthétique.
La fresque dans l’art de différentes régions
Outre la tradition européenne, la peinture à fresque s’est développée dans d’autres cultures. En Inde, par exemple, d’anciennes fresques ont été conservées dans les temples rupestres d’Ajanta et d’Ellora, réalisées entre le IIe siècle av. J.-C. et le VIIe siècle apr. J.-C. Ces peintures, réalisées selon une technique proche de l’alsecco, représentent des scènes de la vie de Bouddha et des paraboles bouddhiques.
La fresque occupait également une place importante dans l’art médiéval arménien. Malgré la conservation fragmentaire du matériel artistique et l’idée erronée d’une attitude négative de l’Église arménienne envers les images, les recherches révèlent une riche tradition de peinture monumentale en Arménie.
Grâce à une étude approfondie des fresques elles-mêmes et des sources écrites médiévales, les scientifiques ont pu démontrer les principales voies de développement de la peinture murale arménienne, identifier les tendances artistiques et les caractéristiques nationales et déterminer les caractéristiques des programmes décoratifs et des variantes iconographiques.
Dans le monde moderne, l’intérêt pour la technique traditionnelle de la fresque ne faiblit pas. De nombreux artistes se tournent vers cet art ancestral, y trouvant de nouvelles possibilités d’expression créative. La peinture à fresque dans un intérieur moderne, privé ou public, peut créer une atmosphère unique et souligner l’individualité de l’espace.
Conservation et restauration des fresques
La préservation des fresques est une tâche difficile en raison de leur vulnérabilité aux influences environnementales. L’humidité, les variations de température, la pollution atmosphérique et les dommages mécaniques peuvent causer des dommages irréparables à ces œuvres d’art.
Après la Seconde Guerre mondiale, des méthodes de séparation successive des couches de peinture monumentale (stacco et strappo) ont été développées, ce qui a permis de sauver de nombreuses fresques menacées de destruction. Ces méthodes ont également permis de découvrir et d’étudier les sinopies, approfondissant ainsi la compréhension du processus de création des fresques.
La méthode stacco consiste à retirer la couche de peinture ainsi qu’une fine couche de plâtre, tandis que la méthode strappo consiste à retirer uniquement la couche de peinture. Ces technologies ont permis de transférer des fresques des murs de bâtiments en ruine vers des musées et de leur offrir des conditions de conservation adéquates.
Les méthodes modernes de restauration de fresques reposent sur le principe d’intervention minimale et de réversibilité. Les restaurateurs s’efforcent de préserver l’authenticité de l’œuvre en utilisant des matériaux compatibles avec l’original et en documentant toutes les étapes du travail.
Un aspect important de la préservation des fresques est la création de conditions environnementales optimales. Le contrôle de la température, de l’humidité et de l’éclairage contribue à ralentir la dégradation de la couche picturale et du support en plâtre.
Pline l’Ancien sur la peinture et les fresques
L’une des sources les plus importantes sur l’histoire de la peinture antique est l’ouvrage de l’encyclopédiste romain Pline l’Ancien, Histoire naturelle, et plus particulièrement son 35e livre. Pline y examine l’histoire de la peinture, mentionne diverses techniques et méthodes d’artisanat artistique, et s’interroge également sur le potentiel pédagogique de l’art.
Pline l’Ancien décrit les origines de la peinture, mentionne le terme monochromatos (peinture monochrome) et son lien avec l’histoire de la peinture grecque antique. Il fournit également de précieuses informations sur les écoles artistiques antiques, notamment l’école scyonienne.
Pline accorde une grande importance à l’artiste Pamphile, fondateur de l’enseignement de la peinture dans toutes les écoles grecques antiques. Il analyse également la différence de perception de l’art entre les Grecs et les Romains, ce qui aide les chercheurs modernes à mieux comprendre le contexte du développement de la fresque dans le monde antique.
Innovations techniques et évolution de la fresque
La technique de la fresque n’est pas restée inchangée : elle a évolué au fil des siècles, s’adaptant aux nouvelles exigences esthétiques et aux possibilités technologiques. Dans différentes régions du monde, les maîtres ont développé leurs propres variantes de la technique classique, enrichissant ainsi le patrimoine artistique mondial.
Dans la Rus’ antique, par exemple, la technique de la peinture murale était principalement mixte : la peinture à l’eau sur plâtre humide était complétée par la technique de la détrempe et de la colle avec divers liants (colles d’œuf, animales et végétales). Les fonds et les peintures supérieures étaient souvent réalisés selon la technique de l’alsecco.
À la Renaissance, les maîtres italiens perfectionnèrent la technique du buon fresco, maîtrisant à la perfection le volume, l’espace et la lumière ambiante. Ils développèrent un système complexe de dessins préparatoires et de cartons, leur permettant de planifier la composition avec précision et de gagner du temps sur le plâtre frais.
Avec le développement de la chimie et de la technologie aux XIXe et XXe siècles, de nouveaux pigments et liants sont apparus, élargissant la palette des fresques. Cependant, les maîtres ont souvent préféré travailler avec des matériaux traditionnels, appréciant leurs qualités éprouvées et leurs possibilités esthétiques.
Dans l’art contemporain, la fresque continue de vivre, acquérant de nouvelles formes et significations. Les artistes expérimentent les techniques, combinant méthodes traditionnelles et matériaux et approches modernes, permettant ainsi à cet art ancien de conserver toute sa pertinence au XXIe siècle.
La fresque est l’une des techniques de peinture monumentale les plus anciennes et les plus durables. Elle a parcouru un long chemin, des images primitives des civilisations antiques aux chefs-d’œuvre de la Haute Renaissance et aux œuvres expérimentales modernes. Ses caractéristiques techniques, exigeant de l’artiste rapidité, précision et une connaissance approfondie des matériaux, en ont fait un art particulier, réservé aux véritables maîtres.
Depuis des millénaires, les fresques ont rempli non seulement des fonctions esthétiques, mais aussi d’importantes fonctions sociales, religieuses et didactiques. Elles reflétaient la vision du monde de l’époque, servaient de moyen de transmission de connaissances et de valeurs, et façonnaient la culture visuelle de la société.
Les recherches et les travaux de restauration modernes nous permettent de mieux comprendre les aspects techniques et artistiques de la fresque, afin de préserver cette précieuse part du patrimoine culturel mondial pour les générations futures. L’intérêt constant des artistes et du public pour cette technique ancestrale témoigne de sa valeur et de sa pertinence durables dans le monde de l’art.